 Les faux-monnayeurs, André Gide
Les faux-monnayeurs, André Gide
Le mot de Sound'
Comme vous ne tarderez guère à vous en apercevoir, c'est une plume différente de la mienne qui intervient aujourd'hui sur Tale me more. Je prête mes pages, pour la seconde fois et avec grand plaisir. Il fallait bien cela pour faire honneur au talent d'André Gide. Après une lecture plus ou moins commune, c'est Jeanne qui a relevé le défi. Je l'en remercie. Je ne manquerai pas de commenter et vous invite à faire de même.
 A ce jeu de conter les ratés, les rendez-vous manqués, les paroles jamais dites à en crever, les regrets sublimes et les passions adolescentes qu’on a le droit d’éprouver y compris à 35 ans (l’un des héros est ainsi un adulte patenté !), j’appelle le roi, le maître, l’orfèvre, j’ai nommé : Gide, André, Gide. Faux Monnayeurs, Les faux monnayeurs.
A ce jeu de conter les ratés, les rendez-vous manqués, les paroles jamais dites à en crever, les regrets sublimes et les passions adolescentes qu’on a le droit d’éprouver y compris à 35 ans (l’un des héros est ainsi un adulte patenté !), j’appelle le roi, le maître, l’orfèvre, j’ai nommé : Gide, André, Gide. Faux Monnayeurs, Les faux monnayeurs.
Coup de foudre de mes 23 ans (une de mes rares éditions à avoir été annotée), coup de foudre dix ans et des poussières plus tard. Comme quoi, un chef d’œuvre ne vieillit pas, sinon pour gagner en maturité, et devenir plus touchant encore. Est-ce possible pourtant qu’à 23 ans je sois passée à côté du thème principal de ce roman : l’homosexualité de certains personnages masculins ? Je suis bien en peine en effet de parler de manière critique de ce récit qui m’a bouleversée et me bouleverse encore, mais je sais dire qu’il ne m’en était rien resté, en dix ans, sinon cette certitude d’avoir aimé, d’avoir aimé de tout mon cœur, à en pleurer peut-être, oui, très sentimentalement, niaisement, sincèrement, dans le creux de mon oreiller. Des thèmes, donc, rien, des personnages, rien non plus, à part une vague reconnaissance à l’énoncé des noms « Olivier Molinier », « Bernard Profitendieu », « Edouard », autant de sésames à présent que je voudrais ne pas oublier et préserver dans mon cœur jusqu’à la prochaine décennie. De l’histoire ? Rien non plus, à tel point que je me suis presque sentie manipulée par l’auteur, à travers ce titre qui ne m’évoquait pas plus de choses, pour m’empêcher encore davantage de faire émerger quelques palpables souvenirs. Car de faux monnayeurs il n’est que peu question ici, sinon dans le dernier tiers du roman, et du moins est-ce de manière annexe, je dirais, en arrière-plan. Mais là encore le doute s’insinue en moi, et de même que j’avais (peut-être) été incapable de lire l’homosexualité des personnages (par pruderie ? naïveté ? sottise plus certainement, car on ne voit que ça en fait !), de même le suis-je peut-être encore à croire que le thème des faux monnayeurs n’est que secondaire, prétexte au récit des amours contrariées de nos personnages. Des cours bien sûr (oui, car je suis étudiante à temps partiel !) éclaireront certainement ma lanterne à ce sujet, et achèveront certainement de me confondre dans mon aveuglement !
Tout cela est bien beau, mais en somme, de quoi s’agit-il, qui remue tant et bouleverse tant ? Rien d’autre somme toute qu’un banal feuilleton amoureux des affres de l’adolescence huppée, arrogante un poil, conquérante à n’en pas douter, du début XXe. Sans doute les avertis et curieux d’Histoire liront-ils ici et là quelques clins d’œil aux avant-gardes et créations de revues (NRF) dont Gide fut en sa jeunesse l’un des créateurs. Pour ma part, ce n’est pas ce qui m’a le plus captivée. Les personnages, des jeunes blancs becs pour les deux principaux, apprentis écrivains, apprentis aventuriers, apprentis dans la vie, s’y jettent à corps perdu avec une audace, une effronterie et une fougue que l’on retrouve dès les premières pages du roman, dans la lettre que Bernard écrit à son père, après avoir découvert que celui-ci n’est justement pas son père :
« Monsieur, j’ai compris à la suite de certaine découverte que j'ai faite par hasard cet après-midi, que je dois cesser de vous considérer comme mon père, et c'est pour moi un immense soulagement. En me sentant si peu d'amour pour vous, j'ai longtemps cru que j'étais un fils dénaturé; je préfère savoir que je ne suis pas votre fils du tout.» (pages 24, 26)
La malice et l’arrogance des personnages évidemment n’auraient pas de quoi nous tenir en haleine, s’il n’y avait le style de Gide, propre à nous faire aimer ces personnages, aussi imbus soient-ils, pour leurs défauts justement davantage que pour leurs qualités. C’est tout l’art de l’écrivain que de nous dresser le portrait d’une jeunesse qui se trompe, se cogne, s’aveugle, recommence et ce faisant nous renvoie un miroir de nos propres vicissitudes. Beau à en pleurer vous dis-je.
Car j’ai parlé de feuilleton, et il me semble bien tenir là quelque chose, dans ce que ce genre aurait de propre à peindre la psychologie des personnages, à ne faire que cela peut-être. Pourquoi n’a-t-on pas alors la sensation d’être dans un roman de gare ? Un roman à l’eau de rose (car tout finit bien, en plus de cela…) ? Car Gide dit et exprime avec une sensibilité inouïe les non dits, les paroles toujours refoulées, par orgueil mal placé ou simple timidité. D’orgueil il est souvent question dans ce roman, qui traite avec emphase* de la question de l’honneur. Mais les personnages sont tellement souvent ramenés à l’expression la plus sincère de leur médiocrité, que la grandiloquence des uns, l’aspiration à de beaux grands idéaux un peu ridicules, est toujours gentiment égratignée, moquée, par la faculté des autres à faire tomber les masques, à voir au-delà des apparences. Et savez-vous quels personnages sont les plus à même de dire, de voir, de sentir et d’admettre ? Les femmes bien sûr : Laura d’abord, la divine Laura, jouet et victime de l’inconstance d’un jeune amant l’ayant mise dans une position délicate (voudrais-je imiter Gide que je n’en garderais que les traits les plus ridicules! Comprenez donc : l’ayant mise enceinte !), très capable de pardonner, de comprendre, de se sacrifier enfin :
« Mon ami,
La dernière fois que je vous ai vu – c’était, vous en souvenez-vous, à St James Park, le 2 avril, la veille de mon départ pour le midi – vous m'avez fait promettre de vous écrire si je me trouvais dans l'embarras. Je tiens ma promesse. A qui d'autre que vous en appellerais-je? […] vais-je oser vous avouer à vous ce qu'à Félix je ne puis dire? Le moment est venu que je devrais le rejoindre. Hélas, je ne suis plus digne de le revoir. Les lettres que je lui écris depuis quelque temps sont menteuses et celles que je reçois de lui ne parlent que de sa joie de me savoir mieux portante. Que ne suis-je demeurée malade! que ne suis-je morte là bas! … Mon ami, j'ai dû me rendre à l'évidence: je suis enceinte; et l'enfant que j'attends n'est pas de lui. J'ai quitté Félix il y a plus de trois mois; de toute manière, à lui du moins, je ne pourrai donner le change. Je n'ose retourner près de lui. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Il est trop bon. Il me pardonnerait sans doute et je ne mérite pas, je ne veux pas qu'il me pardonne. ( pages 72) »
Et surtout, cet autre personnage féminin, nullement dupe et clairvoyante au contraire, la sœur d’Edouard, Pauline, dont on croit un temps qu’elle est elle-même la dupe de son entourage, pour apprendre, d’autant plus ému, qu’elle a en réalité tout compris, tout saisi, depuis le début, concernant son mari, ses fils, jusqu’à l’homosexualité de son frère, leurs faux-semblants et les efforts qu’ils font pour « l’épargner ». Je n’en finirais pas de vouloir vous citer des passages où sa sensibilité et son intelligence surgissent de manière frappante, mais je me contenterais de celui-ci :
« On dirait qu'il a peur de moi. Il a bien tort. Depuis longtemps je suis au courant des relations qu'il entretient... je sais même avec qui. Il croit que je les ignore et prend d'énormes précautions pour me les cacher; mais ces précautions sont si apparentes que plus il se cache, plus il se livre. Chaque fois que, sur le point de sortir, il affecte un air affairé, contrarié, soucieux, je sais qu'il court à son plaisir. J'ai envie de lui dire: ' Mais mon ami, je ne te retiens pas; as-tu peur que je sois jalouse? ' J'en rirais, si j'en avais le coeur. Ma seule crainte, c'est que les enfants ne s'aperçoivent de quelque chose; Il est si distrait, si maladroit! Parfois, sans qu'il s'en doute, je me vois forcée de l'aider, comme si je me prêtais à son jeu. Je finis par m'en amuser presque, je vous assure; j'invente pour lui des excuses; je remets dans la poche de son pardessus des lettres qu’il laisse traîner ». (p272, 273)
Oh et je me rends bien compte à présent que je ne dis rien, je n’ai toujours pas résumé de quoi il s’agit : à la vérité, je suis bien piètre critique de ce roman. Qu’en dire en fin de compte, qui vous fasse aller y voir de plus près ? J’échoue et je rends les armes (à celle qui m’a fait cette commande empoisonnée !), il n’est pas dit que 10 ans après ma première lecture je sache seulement mieux en parler, ni plus clairement. Au moins aurez-vous senti mon enthousiasme, seul fil conducteur de ma piètre lecture. S’il faut vous fier à cela seulement, alors oui, lisez-le, chanceux qui l’avez oublié ou ne l’avez pas encore découvert !
Et pour le plaisir, ce dernier passage :
— Je voudrais savoir si tu éprouves pour Laura … du désir ? »
Bernard devint brusquement très grave.
« C’est bien parce que c’est toi…, commenca‐t‐il. Eh bien ! mon vieux, il se passe en moi ceci de bizarre, c’est que, depuis que je la connais, je n’ai plus de désirs du tout. Moi qui, dans le temps, tu t’en souviens, m’enflammais à la fois pour vingt femmes que je rencontrais dans la rue (et c’est même ce qui me retenait d’en choisir aucune), à présent je crois que je ne puis plus être sensible, jamais plus, à une autre forme de beauté que la sienne ; que je ne pourrai jamais aimer d’autre front que le sien, que ses lèvres, que son regard. Mais c’est de la vénération que j’ai pour elle, et, près d’elle, toute pensée charnelle me semble impie. Je crois que je me méprenais sur moi‐même et que ma nature est très chaste. Grâce à Laura, mes instincts se sont sublimés. Je sens en moi de grandes forces inemployées, je voudrais les mettre en service. J’envie le chartreux qui plie son orgueil sous la règle ; celui à qui l’on dit : ‘‘Je compte sur toi.’’ J’envie le soldat… Ou plutôt, non, je n’envie personne ; mais ma turbulence intérieure m’oppresse et j’aspire à la discipliner.
C’est comme de la vapeur en moi, elle peut s’échapper en sifflant (ça c’est la poésie), actionner des pistons, des roues ; ou même faire éclater la machine. Sais‐tu l’acte par lequel il me semble parfois que je m’exprimerais le mieux ? C’est… Oh ! Je sais bien que je ne me tuerai pas ; mais je comprends admirablement Dmitri Karamazov, lorsqu’il demande à son frère s’il comprend qu’on puisse se tuer par enthousiasme, par simple excès de vie… par éclatement. »
Un extraordinaire rayonnement émanait de tout son être. Comme il s’exprimait bien ! Olivier le contemplait dans une sorte d’extase. « Moi aussi, murmura‐t‐il craintivement, je comprends qu’on se tue ; mais ce serait après avoir goûté une joie si forte que toute la vie qui la suive en pâlisse ; une joie telle qu’on puisse penser : Cela suffit, je suis content, jamais plus je ne … »
Mais Bernard ne l’écoutait pas. Il se tut. À quoi bon parler dans le vide ? Tout son ciel de nouveau s’assombrit. (p265)
Jeanne
*rectificatif : ce sont les personnages qui sont emphatiques et mélodramatiques dans leur manière de voir le monde, non l’écriture, me semble-t-il en fin de compte, qui reste elle, toujours limpide et pure.
 Le bleu est une couleur chaude, Julie Maroh
Le bleu est une couleur chaude, Julie Maroh Cette B.D. là est un cadeau de ma petite soeur (pour Noël... celui de l'année dernière j'espère...) qui m'a dit "tu vas adorer". Comme je regrette de l'avoir laissée si longtemps dans ma p.a.l, quelle claque! J'ai fondu en larmes dans les dernières pages, après avoir été pas mal bousculée pendant la lecture. Et ensuite, je n'ai pas pu m'arrêter pendant au moins un quart d'heure. Un de ces gros chagrins d'émotion, venus du fond du coeur dont on ne saurait expliquer clairement l'origine. Simplement, on sent que ça touche là où c'est à vif.
Cette B.D. là est un cadeau de ma petite soeur (pour Noël... celui de l'année dernière j'espère...) qui m'a dit "tu vas adorer". Comme je regrette de l'avoir laissée si longtemps dans ma p.a.l, quelle claque! J'ai fondu en larmes dans les dernières pages, après avoir été pas mal bousculée pendant la lecture. Et ensuite, je n'ai pas pu m'arrêter pendant au moins un quart d'heure. Un de ces gros chagrins d'émotion, venus du fond du coeur dont on ne saurait expliquer clairement l'origine. Simplement, on sent que ça touche là où c'est à vif.



 2 soeurs, Matt Kindt
2 soeurs, Matt Kindt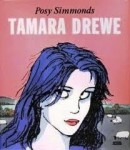 Tamara Drewe, Posy Simmonds
Tamara Drewe, Posy Simmonds Françoise, Dupuy & Berberian
Françoise, Dupuy & Berberian